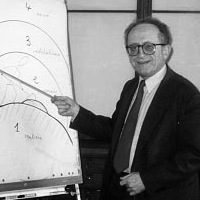
Claude Riveline
ParisTech Review – Vous êtes l’une des figures emblématiques du Centre de gestion scientifique de Mines ParisTech, en fait, son fondateur, et c’est peut-être par-là que nous pourrions commencer cet entretien, avec une question en forme de provocation : l’idée d’une gestion totalement rationnelle, proprement scientifique, de l’entreprise, n’est-elle pas une chimère ?
Claude Riveline – Au sens de l’organisation scientifique du travail, c’est incontestablement une idée qui a fait son temps. Non qu’elle ait été chimérique au temps de Fayol ou de Taylor, mais il y a déjà plusieurs décennies qu’on n’y fait plus référence qu’au passé. En 1985 déjà, Michel Berry avait coordonné un numéro spécial de la revue La Jaune et la Rouge intitulé : « Les sciences de gestion. Que sont devenus les rêves de 1960 ? » Il était déjà évident à ce moment que de ces rêves – optimiser, rationaliser l’entreprise, la ville, la société – il ne restait pour ainsi dire qu’un champ de ruines.
On m’avait confié la tâche de conclure le numéro. Pas facile ! Le déclic est venu avec cette formule de Descartes, qui se promet, dans le Discours de la Méthode, de « ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment pour être telle, c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention ». J’ai compris que si l’objet observé est éphémère ou relève simplement de l’opinion, il ne relève pas de la science, car précipitation ou prévention sont alors inévitables. C’est ce que j’ai choisi d’appeler le « mou », par opposition au « dur ». Dans le grand rêve rationalisateur des années 1960, il y a du dur et du mou. Le dur a obtenu des victoires, la science a progressé, une forme de rationalité s’est développée dans les organisations, dans la société. Mais le mou s’est amplifié, avec l’accélération du temps.
Le problème, c’est quand on veut durcir le mou. Cela ne marche jamais – même si cela permet de poser de bonnes questions. Il y a une misère du mou durci : prenez le communisme, des millions de morts au nom du matérialisme dialectique, une pensée molle qui a été prise pour une pensée scientifique. Le libéralisme n’est pas en reste, d’ailleurs, en termes d’aveuglement et de prétention à la scientificité.
Il y a là une leçon : on ne peut durcir le mou qu’avec prudence. Cette leçon peut nous aider à dégager le sens de ce que pourrait être une « gestion scientifique ». Non pas une pratique qui s’instituerait en science et s’érigerait en dogme, mais bien plutôt un regard attaché à dégager la vérité sous les apparences. En peu de mots, je dirai que ce qui reste de dur dans la gestion d’aujourd’hui tient à ce que d’une part chacun optimise les critères sur lesquels il se sent jugé et à ce que d’autre part ces critères sont maintenus en place par des rituels rigides. Mais ces critères sont des réalités seulement locales.
À première vue, la gestion peut être perçue comme quelque chose de brutal, voire violent. Mais derrière, il y a une structure. Les apparences suggèrent des passions, la réalité est localement logique. Toute la question est donc d’accéder à cette logique, et un regard scientifique cherchera précisément à la révéler. Cela suppose de se demander ce qui cache la structure, ce qui fait qu’elle se dérobe. Les sciences de gestion, au sens que nous leur donnons au Centre de gestion scientifique, ont donc pour objet de dégager ce qu’il y a de solide, de valide, dans les pratiques de gestion, sans s’en tenir aux apparences.
Mais précisément, souvent les pratiques sont enrobées dans un discours apparemment rationnel, qui lisse les aspérités et finit par aveugler.
C’est vrai, et c’est sans doute une particularité des dites « sciences de gestion », que d’avoir produit autant d’obscurité alors même qu’elles avaient vocation à éclairer les pratiques. Deux raisons à cela. Tout d’abord, plus que d’autres ces sciences interfèrent avec le champ qu’elles étudient : l’observateur produit des analyses qui ont des effets sur les pratiques managériales. Elles peuvent ainsi tourner à la prophétie auto-réalisatrice, comme les grandes idéologies du XXe siècle. Deuxième raison, ces sciences sont aux prises avec un matériel dont on ne sait jamais exactement à quel point il est singulier et à quel point il est universel. Toutes les organisations obéissent à quelques règles simples et universelles, et en même temps toutes sont uniques.
Une organisation de travail, c’est ainsi un enchevêtrement déjà complexe d’universel et de singulier, et cet enchevêtrement est d’autant plus difficile à saisir qu’il se donne à voir – qu’il se cache – sous les apparences d’un discours simplificateur. L’entreprise est plus mystérieuse aujourd’hui que ne l’était le corps humain au Moyen-Âge, mais on discourt abondamment. Et ces discours procèdent d’une rhétorique dont la pauvreté est tout simplement affligeante. C’est une flûte à trois trous, qui joue toujours la même musique.
C’est dans ce contexte que prend sens le projet d’une approche scientifique, qui aura pour vocation d’identifier le dur dans le mou. Mais le dur, ce ne sera pas forcément telle ou telle théorie managériale. Ce pourra être tout autre chose. Prenons un exemple. Je reçois récemment un dirigeant désespéré, et à mesure qu’il essaie de m’exposer son problème j’identifie le véritable problème : un conflit entre un sédentaire et un nomade, c’est-à-dire entre un fabricant, attaché à la continuité, et un commerçant, attaché au mouvement. Dans ce cas ce sont des catégories issues de l’anthropologie qui m’aident à comprendre la réalité humaine complexe avec laquelle se débat mon interlocuteur. Je pourrais vous donner d’autres exemples – ainsi un conflit structurel, dans un ministère, entre le Cabinet et les Directions, conflit qui ne peut être compris si l’on s’en tient aux motifs pourtant rationnels invoqués par les parties, qui peine par ailleurs à être formalisé dans le prêt-à-porter des théories du management, mais qui peut se comprendre en allant au-delà des apparences.
Ce travail de dévoilement, d’accès à la structure, me semble la véritable vocation des sciences de gestion. Elles ont à cet égard une ambition qui est beaucoup plus descriptive que prescriptive : leur visée est de comprendre, éventuellement de modéliser, mais certainement pas de dire comment faire.
Néanmoins, vous-même enseignez, et vous avez d’ailleurs formé des générations de dirigeants.
Bien entendu, il ne s’agit pas de se réfugier derrière un idéal scientifique pour refuser le contact avec le réel ! Mais justement, d’avoir eu l’occasion de former la quasi-intégralité du Corps des Mines incite à la modestie quant à ce qu’on peut enseigner en matière de gestion. Et ce peut être ici l’occasion de préciser ma pensée.
Certains des dirigeants que j’ai vu passer à l’Ecole des Mines se sont montrés capables de performances extraordinaires. Aussi bien dans les réussites, les stratégies audacieuses et bien définies, que dans une capacité hors du commun à manœuvrer le navire par gros temps. Patrick Kron, le patron d’Alstom, a dû licencier des milliers de personnes quand l’entreprise était au creux de la vague, et il l’a fait sans un seul jour de grève. Je ne dis pas que ce soit un idéal à imiter, bien sûr ! Mais dans ce cas il fallait le faire pour sauver l’entreprise et cette mission requérait un savoir-faire hors du commun. Comment qualifier ces capacités, ces performances ? On peut parler, dans son cas comme dans d’autres, de talent, voire de génie – à mes yeux les grands dirigeants ont du génie. Or ce talent, voire ce génie, sont à l’évidence très difficiles à formaliser.
On pourrait avancer cette définition du talent : dépasser les peurs de l’homme ordinaire. Quant au génie, il ne relève pas tant d’une qualité, à mes yeux, que d’une position : l’homme de génie n’accepte pas le monde tel qu’il l’a trouvé. Dans les formations d’élite, d’une certaine façon la question du talent ne se pose pas : non seulement les étudiants sont brillants, mais l’accès à une filière d’élite les débarrasse de l’essentiel des peurs qui paralysent ou entravent la plupart d’entre nous. Toute la question est alors de les tirer vers le génie. Et on revient ici à ce que chacun a d’unique, de singulier. Le génie ne s’apprend pas, il ne se formalise pas – tout ce qu’on peut faire c’est d’encourager son développement. Pour un enseignant, c’est un luxe de travailler dans des conditions où l’on essaie de développer l’excellence de chacun, et non simplement d’amener tout le monde à la norme. Mais cela oblige aussi à une certaine humilité, car vous savez très bien que ce ne sont pas vos recettes, ou vos méthodes, qui feront les succès futurs de ces hommes et ces femmes.
Cette vision du dirigeant a quelque chose de lyrique, elle est en tout cas originale. Auriez-vous pu la formuler dans les années 1960 – au temps où l’on rêvait de rationaliser le monde, où le dirigeant idéal était une sorte de super-ingénieur ?
Probablement pas, car comme vous le notez vous-même ce que nous voulons faire du monde est très différent aujourd’hui. Dans les années 1960 on rêvait de le mettre en ordre, et dans cette mise en ordre le dirigeant avait un rôle bien particulier : il décidait un changement et donnait des ordres pour sa mise en œuvre. Il y avait quelque chose de souverain dans cette position, et en même temps quelque chose d’impersonnel.
Un dirigeant, aujourd’hui, se définit toujours par le changement, mais on lui demande beaucoup plus. Le chef, c’est celui qui invente les rêves des autres. Cela nous a conduits à développer une sorte de mythologie du dirigeant, dont la figure de Steve Jobs, l’ancien patron d’Apple, est un peu l’idéal : un visionnaire, capable de changer le monde et de créer des rêves.
Prenons Jobs, justement. On parlait volontiers de charisme, et ses présentations étaient régulièrement comparées à une grand-messe. N’y a-t-il pas dans cette figure du « grand dirigeant » des éléments religieux ?
C’est incontestable, et c’est l’une des dimensions de cette évolution de la figure du dirigeant – de la même façon que le cadre, le manager, se sont mués en « animateurs », chargés de donner une âme (anima) à leurs équipes.
Mais nous arrivons ici dans ce qui me semble justement l’une des zones obscures de l’entreprise contemporaine : sa prétention à s’affirmer non pas simplement comme une organisation efficace, mais comme une communauté spirituelle, pour laquelle on ne se contente pas de travailler ou même d’œuvrer, mais aux valeurs de laquelle on adhère. La multiplication des « chartes de valeurs » et l’affirmation tous azimuts de principes éthiques vont dans ce sens.
Là encore, on a du dur et du mou. Le mou, c’est à l’évidence tout le côté « communication corporate » de cet imaginaire religieux, qui par certains côtés est franchement ridicule. Le dur est beaucoup plus intéressant, et on peut l’approcher à travers la notion de « rite », notion que j’ai déjà mentionnée et qui me semble très éclairante. Si l’on approche l’entreprise à la manière d’un anthropologue, en y voyant une communauté humaine comme une autre, on peut décrire son fonctionnement comme celui d’une tribu, ayant recours aux mythes et aux rites pour s’organiser.
La décrire ainsi permet de l’éclairer sous une lumière différente, qui pourra faire sourire ou agacer – les chercheurs en sciences de gestion y verront une méthode peu rigoureuse, et plus largement une telle manière de voir a quelque chose d’offensant pour un Occidental cartésien. Mais nous sommes peut-être en train de vivre la fin du siècle des Lumières, et il est temps de s’apercevoir que ni le monde, ni l’esprit – et pas davantage les entreprises – ne fonctionnent de la façon dont on l’avait rêvé depuis Descartes. Nous nous sommes enivrés de pensée mathématique, et la tendance actuelle à tout quantifier, particulièrement sensible dans les entreprises désormais gouvernées par des indicateurs, a très certainement atteint ses limites. Car bien souvent on ne peut appréhender la réalité à travers le calcul. L’homme n’est pas un « calculateur rationnel », ou plus exactement il ne l’est que rarement. D’une certaine façon, on pourrait décrire l’usage des chiffres comme un rite moderne.
Un sujet embarrassant pour les matheux est ainsi l’urgence. Le calcul économique suppose un temps infini pour choisir. Or on choisit dans l’urgence, et l’urgence est bien souvent la seule manière d’agir, car elle permet de trancher les contradictions. Et c’est là, précisément, que les rites sont utiles. Les médecins hospitaliers, par exemple, sont continuellement confrontés à l’urgence et à la nécessité de choisir rapidement, avec des conséquences très lourdes. Pour traiter cette urgence ils ont développé des rites, seule manière de conserver une efficacité et de faire face à une réalité à la fois complexe et éprouvante.
Le pouvoir du geste sur la pensée, vérité choquante, est considérable. Les rites, ce sont des gestes qui tiennent lieu de pensée. C’est aussi ce qui fait tenir la tribu, avec les mythes. Et au fil du temps j’ai acquis la conviction que le grand dirigeant, ce n’est pas seulement un bon calculateur ou une intelligence supérieure, c’est aussi et peut-être avant tout quelqu’un qui est sensible aux rites et qui peut les mobiliser. Une stratégie qui ne s’appuierait pas sur les rites n’a pas de prise sur les hommes et les femmes qui composent l’entreprise.
Un bon dirigeant ne sera pas forcément charismatique comme l’était Steve Jobs : Georges Besse, l’homme qui a sauvé Renault dans les années 1980, était silencieux, austère – il n’avait rien d’un gourou. Mais c’était un dirigeant extraordinaire parce qu’il avait cette compréhension intime de ce qui faisait l’entreprise, de ce qui la faisait tenir humainement. Un bon dirigeant, c’est ainsi quelqu’un qui est capable de se déplacer dans les rites, les mythes, et les tribus.
Claude Riveline
BIO
A General Mining Engineer, Claude Riveline graduated from Ecole Polytechnique in 1956 and Mines ParisTech in 1961. He decided for teaching and researching, and for over 50 years he has been a professor in Mines ParisTech. In the 60s he founded the Scientific Management Lab (Centre de gestion scientifique), dedicating himself and his team to understanding what works – and what doesn’t – within organizations.
He has published many articles and several books, among them Evaluations des copurs (Cost Assessment and Evaluation, Presses de l’Ecole des Mines, 2005).
Claude Riveline – Au sens de l’organisation scientifique du travail, c’est incontestablement une idée qui a fait son temps. Non qu’elle ait été chimérique au temps de Fayol ou de Taylor, mais il y a déjà plusieurs décennies qu’on n’y fait plus référence qu’au passé. En 1985 déjà, Michel Berry avait coordonné un numéro spécial de la revue La Jaune et la Rouge intitulé : « Les sciences de gestion. Que sont devenus les rêves de 1960 ? » Il était déjà évident à ce moment que de ces rêves – optimiser, rationaliser l’entreprise, la ville, la société – il ne restait pour ainsi dire qu’un champ de ruines.
On m’avait confié la tâche de conclure le numéro. Pas facile ! Le déclic est venu avec cette formule de Descartes, qui se promet, dans le Discours de la Méthode, de « ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment pour être telle, c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention ». J’ai compris que si l’objet observé est éphémère ou relève simplement de l’opinion, il ne relève pas de la science, car précipitation ou prévention sont alors inévitables. C’est ce que j’ai choisi d’appeler le « mou », par opposition au « dur ». Dans le grand rêve rationalisateur des années 1960, il y a du dur et du mou. Le dur a obtenu des victoires, la science a progressé, une forme de rationalité s’est développée dans les organisations, dans la société. Mais le mou s’est amplifié, avec l’accélération du temps.
Le problème, c’est quand on veut durcir le mou. Cela ne marche jamais – même si cela permet de poser de bonnes questions. Il y a une misère du mou durci : prenez le communisme, des millions de morts au nom du matérialisme dialectique, une pensée molle qui a été prise pour une pensée scientifique. Le libéralisme n’est pas en reste, d’ailleurs, en termes d’aveuglement et de prétention à la scientificité.
Il y a là une leçon : on ne peut durcir le mou qu’avec prudence. Cette leçon peut nous aider à dégager le sens de ce que pourrait être une « gestion scientifique ». Non pas une pratique qui s’instituerait en science et s’érigerait en dogme, mais bien plutôt un regard attaché à dégager la vérité sous les apparences. En peu de mots, je dirai que ce qui reste de dur dans la gestion d’aujourd’hui tient à ce que d’une part chacun optimise les critères sur lesquels il se sent jugé et à ce que d’autre part ces critères sont maintenus en place par des rituels rigides. Mais ces critères sont des réalités seulement locales.
À première vue, la gestion peut être perçue comme quelque chose de brutal, voire violent. Mais derrière, il y a une structure. Les apparences suggèrent des passions, la réalité est localement logique. Toute la question est donc d’accéder à cette logique, et un regard scientifique cherchera précisément à la révéler. Cela suppose de se demander ce qui cache la structure, ce qui fait qu’elle se dérobe. Les sciences de gestion, au sens que nous leur donnons au Centre de gestion scientifique, ont donc pour objet de dégager ce qu’il y a de solide, de valide, dans les pratiques de gestion, sans s’en tenir aux apparences.
Mais précisément, souvent les pratiques sont enrobées dans un discours apparemment rationnel, qui lisse les aspérités et finit par aveugler.
C’est vrai, et c’est sans doute une particularité des dites « sciences de gestion », que d’avoir produit autant d’obscurité alors même qu’elles avaient vocation à éclairer les pratiques. Deux raisons à cela. Tout d’abord, plus que d’autres ces sciences interfèrent avec le champ qu’elles étudient : l’observateur produit des analyses qui ont des effets sur les pratiques managériales. Elles peuvent ainsi tourner à la prophétie auto-réalisatrice, comme les grandes idéologies du XXe siècle. Deuxième raison, ces sciences sont aux prises avec un matériel dont on ne sait jamais exactement à quel point il est singulier et à quel point il est universel. Toutes les organisations obéissent à quelques règles simples et universelles, et en même temps toutes sont uniques.
Une organisation de travail, c’est ainsi un enchevêtrement déjà complexe d’universel et de singulier, et cet enchevêtrement est d’autant plus difficile à saisir qu’il se donne à voir – qu’il se cache – sous les apparences d’un discours simplificateur. L’entreprise est plus mystérieuse aujourd’hui que ne l’était le corps humain au Moyen-Âge, mais on discourt abondamment. Et ces discours procèdent d’une rhétorique dont la pauvreté est tout simplement affligeante. C’est une flûte à trois trous, qui joue toujours la même musique.
C’est dans ce contexte que prend sens le projet d’une approche scientifique, qui aura pour vocation d’identifier le dur dans le mou. Mais le dur, ce ne sera pas forcément telle ou telle théorie managériale. Ce pourra être tout autre chose. Prenons un exemple. Je reçois récemment un dirigeant désespéré, et à mesure qu’il essaie de m’exposer son problème j’identifie le véritable problème : un conflit entre un sédentaire et un nomade, c’est-à-dire entre un fabricant, attaché à la continuité, et un commerçant, attaché au mouvement. Dans ce cas ce sont des catégories issues de l’anthropologie qui m’aident à comprendre la réalité humaine complexe avec laquelle se débat mon interlocuteur. Je pourrais vous donner d’autres exemples – ainsi un conflit structurel, dans un ministère, entre le Cabinet et les Directions, conflit qui ne peut être compris si l’on s’en tient aux motifs pourtant rationnels invoqués par les parties, qui peine par ailleurs à être formalisé dans le prêt-à-porter des théories du management, mais qui peut se comprendre en allant au-delà des apparences.
Ce travail de dévoilement, d’accès à la structure, me semble la véritable vocation des sciences de gestion. Elles ont à cet égard une ambition qui est beaucoup plus descriptive que prescriptive : leur visée est de comprendre, éventuellement de modéliser, mais certainement pas de dire comment faire.
Néanmoins, vous-même enseignez, et vous avez d’ailleurs formé des générations de dirigeants.
Bien entendu, il ne s’agit pas de se réfugier derrière un idéal scientifique pour refuser le contact avec le réel ! Mais justement, d’avoir eu l’occasion de former la quasi-intégralité du Corps des Mines incite à la modestie quant à ce qu’on peut enseigner en matière de gestion. Et ce peut être ici l’occasion de préciser ma pensée.
Certains des dirigeants que j’ai vu passer à l’Ecole des Mines se sont montrés capables de performances extraordinaires. Aussi bien dans les réussites, les stratégies audacieuses et bien définies, que dans une capacité hors du commun à manœuvrer le navire par gros temps. Patrick Kron, le patron d’Alstom, a dû licencier des milliers de personnes quand l’entreprise était au creux de la vague, et il l’a fait sans un seul jour de grève. Je ne dis pas que ce soit un idéal à imiter, bien sûr ! Mais dans ce cas il fallait le faire pour sauver l’entreprise et cette mission requérait un savoir-faire hors du commun. Comment qualifier ces capacités, ces performances ? On peut parler, dans son cas comme dans d’autres, de talent, voire de génie – à mes yeux les grands dirigeants ont du génie. Or ce talent, voire ce génie, sont à l’évidence très difficiles à formaliser.
On pourrait avancer cette définition du talent : dépasser les peurs de l’homme ordinaire. Quant au génie, il ne relève pas tant d’une qualité, à mes yeux, que d’une position : l’homme de génie n’accepte pas le monde tel qu’il l’a trouvé. Dans les formations d’élite, d’une certaine façon la question du talent ne se pose pas : non seulement les étudiants sont brillants, mais l’accès à une filière d’élite les débarrasse de l’essentiel des peurs qui paralysent ou entravent la plupart d’entre nous. Toute la question est alors de les tirer vers le génie. Et on revient ici à ce que chacun a d’unique, de singulier. Le génie ne s’apprend pas, il ne se formalise pas – tout ce qu’on peut faire c’est d’encourager son développement. Pour un enseignant, c’est un luxe de travailler dans des conditions où l’on essaie de développer l’excellence de chacun, et non simplement d’amener tout le monde à la norme. Mais cela oblige aussi à une certaine humilité, car vous savez très bien que ce ne sont pas vos recettes, ou vos méthodes, qui feront les succès futurs de ces hommes et ces femmes.
Cette vision du dirigeant a quelque chose de lyrique, elle est en tout cas originale. Auriez-vous pu la formuler dans les années 1960 – au temps où l’on rêvait de rationaliser le monde, où le dirigeant idéal était une sorte de super-ingénieur ?
Probablement pas, car comme vous le notez vous-même ce que nous voulons faire du monde est très différent aujourd’hui. Dans les années 1960 on rêvait de le mettre en ordre, et dans cette mise en ordre le dirigeant avait un rôle bien particulier : il décidait un changement et donnait des ordres pour sa mise en œuvre. Il y avait quelque chose de souverain dans cette position, et en même temps quelque chose d’impersonnel.
Un dirigeant, aujourd’hui, se définit toujours par le changement, mais on lui demande beaucoup plus. Le chef, c’est celui qui invente les rêves des autres. Cela nous a conduits à développer une sorte de mythologie du dirigeant, dont la figure de Steve Jobs, l’ancien patron d’Apple, est un peu l’idéal : un visionnaire, capable de changer le monde et de créer des rêves.
Prenons Jobs, justement. On parlait volontiers de charisme, et ses présentations étaient régulièrement comparées à une grand-messe. N’y a-t-il pas dans cette figure du « grand dirigeant » des éléments religieux ?
C’est incontestable, et c’est l’une des dimensions de cette évolution de la figure du dirigeant – de la même façon que le cadre, le manager, se sont mués en « animateurs », chargés de donner une âme (anima) à leurs équipes.
Mais nous arrivons ici dans ce qui me semble justement l’une des zones obscures de l’entreprise contemporaine : sa prétention à s’affirmer non pas simplement comme une organisation efficace, mais comme une communauté spirituelle, pour laquelle on ne se contente pas de travailler ou même d’œuvrer, mais aux valeurs de laquelle on adhère. La multiplication des « chartes de valeurs » et l’affirmation tous azimuts de principes éthiques vont dans ce sens.
Là encore, on a du dur et du mou. Le mou, c’est à l’évidence tout le côté « communication corporate » de cet imaginaire religieux, qui par certains côtés est franchement ridicule. Le dur est beaucoup plus intéressant, et on peut l’approcher à travers la notion de « rite », notion que j’ai déjà mentionnée et qui me semble très éclairante. Si l’on approche l’entreprise à la manière d’un anthropologue, en y voyant une communauté humaine comme une autre, on peut décrire son fonctionnement comme celui d’une tribu, ayant recours aux mythes et aux rites pour s’organiser.
La décrire ainsi permet de l’éclairer sous une lumière différente, qui pourra faire sourire ou agacer – les chercheurs en sciences de gestion y verront une méthode peu rigoureuse, et plus largement une telle manière de voir a quelque chose d’offensant pour un Occidental cartésien. Mais nous sommes peut-être en train de vivre la fin du siècle des Lumières, et il est temps de s’apercevoir que ni le monde, ni l’esprit – et pas davantage les entreprises – ne fonctionnent de la façon dont on l’avait rêvé depuis Descartes. Nous nous sommes enivrés de pensée mathématique, et la tendance actuelle à tout quantifier, particulièrement sensible dans les entreprises désormais gouvernées par des indicateurs, a très certainement atteint ses limites. Car bien souvent on ne peut appréhender la réalité à travers le calcul. L’homme n’est pas un « calculateur rationnel », ou plus exactement il ne l’est que rarement. D’une certaine façon, on pourrait décrire l’usage des chiffres comme un rite moderne.
Un sujet embarrassant pour les matheux est ainsi l’urgence. Le calcul économique suppose un temps infini pour choisir. Or on choisit dans l’urgence, et l’urgence est bien souvent la seule manière d’agir, car elle permet de trancher les contradictions. Et c’est là, précisément, que les rites sont utiles. Les médecins hospitaliers, par exemple, sont continuellement confrontés à l’urgence et à la nécessité de choisir rapidement, avec des conséquences très lourdes. Pour traiter cette urgence ils ont développé des rites, seule manière de conserver une efficacité et de faire face à une réalité à la fois complexe et éprouvante.
Le pouvoir du geste sur la pensée, vérité choquante, est considérable. Les rites, ce sont des gestes qui tiennent lieu de pensée. C’est aussi ce qui fait tenir la tribu, avec les mythes. Et au fil du temps j’ai acquis la conviction que le grand dirigeant, ce n’est pas seulement un bon calculateur ou une intelligence supérieure, c’est aussi et peut-être avant tout quelqu’un qui est sensible aux rites et qui peut les mobiliser. Une stratégie qui ne s’appuierait pas sur les rites n’a pas de prise sur les hommes et les femmes qui composent l’entreprise.
Un bon dirigeant ne sera pas forcément charismatique comme l’était Steve Jobs : Georges Besse, l’homme qui a sauvé Renault dans les années 1980, était silencieux, austère – il n’avait rien d’un gourou. Mais c’était un dirigeant extraordinaire parce qu’il avait cette compréhension intime de ce qui faisait l’entreprise, de ce qui la faisait tenir humainement. Un bon dirigeant, c’est ainsi quelqu’un qui est capable de se déplacer dans les rites, les mythes, et les tribus.
Claude Riveline
BIO
A General Mining Engineer, Claude Riveline graduated from Ecole Polytechnique in 1956 and Mines ParisTech in 1961. He decided for teaching and researching, and for over 50 years he has been a professor in Mines ParisTech. In the 60s he founded the Scientific Management Lab (Centre de gestion scientifique), dedicating himself and his team to understanding what works – and what doesn’t – within organizations.
He has published many articles and several books, among them Evaluations des copurs (Cost Assessment and Evaluation, Presses de l’Ecole des Mines, 2005).
Ce contenu est issu de ParisTech Review où il a été publié à l’origine sous le titre " Mythes, rites et tribus : un autre visage du dirigeant
".
Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à ParisTech Review.
Autres articles
-
Mon Petit Placement se place auprès du grand public
-
Shine : les deux co-fondateurs passent la main à la direction de la fintech
-
Spendesk fait l’acquisition d’Okko pour mutualiser la gestion des achats et des dépenses
-
Deblock, néobanque crypto friendly, lève 12 millions d'euros
-
Olky, lancement de Kypay on-chain par OlkyPay














